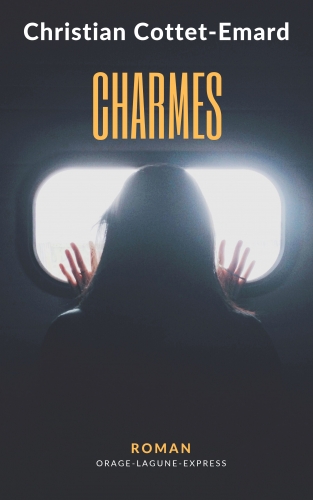13 mai 2021
Vient de paraître :
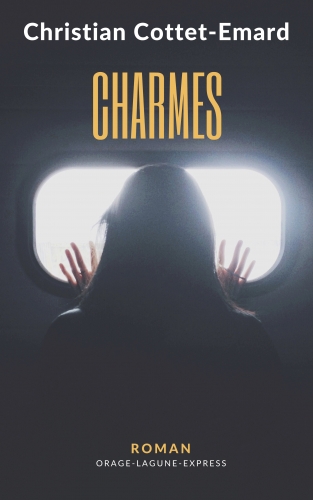
Quatrième de couverture :
Passionné de musique mais dans l’incapacité de la pratiquer, Charles vit seul, au bord du monde. Il rédige son journal intime.
À la suite de son étrange rencontre avec l’inquiétante et mystérieuse Marina, il se trouve subitement en possession de ce don musical dont il a toujours rêvé et qui fait de lui un autre homme en l’entraînant sous les feux de la rampe. Mais le halo des projecteurs ne protège qu’un temps de ce qui réclame la part de l’ombre.
Avoir un don, n’est-ce pas être hanté ? Qu’apporte un don dans une vie ? Peut-on le négliger, s’en détourner, le fuir ? Un don fait-il un destin ? Peut-il être un fardeau ? Ne sommes-nous que ce que nous faisons ?
Dans ce roman aux limites du fantastique, comme dans une fable, Christian Cottet-Emard pose ces questions qui nous concernent tous dans un récit que chaque personnage raconte de son point de vue.
À qui voudra bien s’y intéresser d’assembler les pièces du puzzle en prenant quelques détours par Oyonnax et Nantua, dans la région natale de l’auteur, ainsi qu'à Lyon, Barcelone, Venise et Lisbonne où s’aventure cette histoire d’un vertige.
En savoir plus : informations et commandes.
Éditions Orage-Lagune-Express.
01:10 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charmes, roman, christian cottet-emard, éditions orage lagune express, littérature, fiction, blog littéraire de christian cottet-emard, parution, publication, édition, musique, piano, pianiste, orgue, oyonnax, nantua, lyon, barcelone, venise, lisbonne, france, espagne, italie, portugal, jura, rhône-alpes, rhône
22 avril 2021
Un bref extrait de mon roman CHARMES (parution fin avril)
Le deuxième épisode bizarre me laissa dans un plus grand malaise. La rue déserte de mon hôtel baignait dans le crépuscule d’un ciel bleu foncé, profond, barré à l’horizon d’une bande turquoise qui alourdissait les contrastes entre l’éclairage jaune et la grande façade vert amande de l’immeuble d’en face. Je croisai une femme entre deux âges, corpulente, vêtue d’une blouse et portant un cabas rempli de produits de nettoyage, comme si elle sortait de son travail. En me voyant elle s’exclama : Monsieur Jenkins ! Elle s’approcha et répéta : Monsieur Jenkins ! Passé l’effet de surprise, je lui répondis qu’elle faisait une erreur mais elle insistait. Écoutez, je ne suis pas Monsieur Jenkins, vous vous trompez, je vous prie de me laisser tranquille. Je lisais de l’incompréhension dans ses yeux. Elle se tut, me jeta un regard incrédule et chagriné comme si j’avais fait preuve de mépris à son égard puis s’éloigna enfin.
(Photo Christian Cottet-Emard)
22:24 Publié dans Atelier | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charmes, roman, christian cottet-emard, lisbonne, portugal, aaron jenkins, antoine marie magnard mongins de la force, rédacteur, blog littéraire de christian cottet-emard, fiction, littérature, principe real
16 avril 2021
Bientôt :
23:59 Publié dans Atelier, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charmes, roman, christian cottet-emard, parution, publication, édition, fiction, blog littéraire de christian cottet-emard