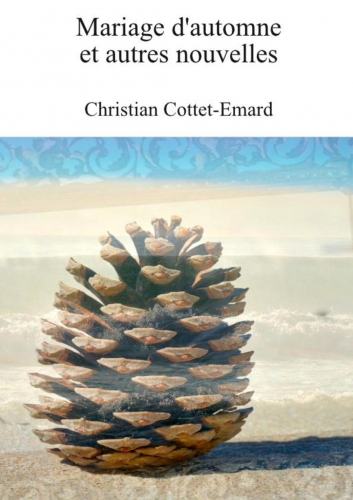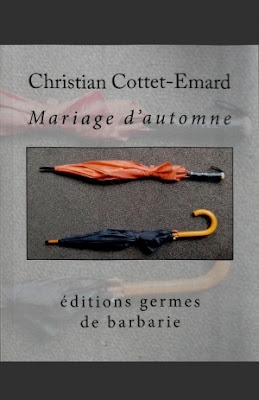04 juillet 2022
Nouvelle / Mariage d'automne

16:27 Publié dans Nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, prose, littérature, fiction rmanesque, christian cottet-emard, littérature sentimentale, blog littéraire de christian cottet-emard, été, automne, mariage, éditions germes de barbarie, le fleix, dordogne, périgord, france, europe, aquitaine, mariage d'automne, pomme de pin, océan, dunes, forêt, bord de mer, plage, marée, phare, tristan, helga, andrade, panicauts, escarpins
10 septembre 2020
Des amis avec un gros chien noir
Je remets en ligne cette nouvelle écrite à la suite d'un cauchemar que la récente actualité m'a rappelé.
1
En chemin vers son domicile, Earl Lediable leva les yeux en direction du crépuscule et constata que les nuages avançaient vite. Hormis un changement de temps, que pouvait signifier l’avance rapide des nuages ? Rien, probablement. Et d’abord cette vapeur d’eau, avance-t-elle ou recule-t-elle ? Le monde est indéchiffrable pensa Earl Lediable, sans pour autant juger utile de formuler cette pensée en une réflexion construite, et il continua sa route vers l’invisible horizon dissimulé par les autos en stationnement et les constructions de la ville. Malgré le claquement de ses talons qui indiquait un sol dur et stable, il marchait dans l’univers des nuées, les altostratus violets au-dessus de sa tête et, à l’intérieur de son crâne, ses pensées confuses. Tout de même, il avait nettement conscience que tout cela ne pesait pas lourd et qu’il y avait là au moins une certitude. Le temps de laisser enfler puis s’évaporer d’autres songeries du même style dans son esprit, Earl Lediable l’employa aussi à repérer la nuit qui s’avançait au ralenti telle une grosse locomotive arrivant à quai dans un concert de soupirs feutrés. L’entrée de sa maison apparut alors dans le tressaillement des ampoules de l’éclairage public mais lorsqu’il voulut franchir le seuil, son regard buta sur un gros chien noir, patibulaire, vautré devant la porte d’entrée. Lorsqu’il fit mine de l’enjamber, le chien retroussa les babines, grogna et montra les dents. À la deuxième tentative, le chien dressa les oreilles et grogna plus fort. Earl Lediable préféra ne pas insister et décida d’aller prendre l’apéritif chez ses amis. Il les trouva comme toujours, à cette heure-là, les femmes tentant d’empêcher des bambins surexcités de renverser les verres de leurs hommes bien partis pour se quereller à propos de ballons et d’arbitres. Ils éclatèrent tous de rire quand Earl Lediable leur eut expliqué qu’un molosse noir l’empêchait d’ouvrir sa porte en lui barrant le chemin. Il contempla ces gens qui riaient de sa mésaventure, ses amis, leurs bouches, celles des femmes avec des traces de rouge à lèvre sur les dents, et celles des hommes qui évacuaient des quantités variables de fumée dans la figure de leur progéniture gonflée de chips et de biscuits salés. Il avait pour amis cette bande de crétins mais puisqu’il se considérait lui-même comme un crétin, il n’avait pas de raison de se plaindre et il se mit à rire lui aussi pour ne plus avoir peur et pour éloigner l’idée du chaos et de la fin du monde civilisé.
2
Peu avant minuit, malgré l’odeur qui l’incommodait, Earl Lediable finit par renoncer à fouiller chaque recoin de sa maison. Il se prépara pour se coucher, inspecta une dernière fois la salle de bain sinistre mais d’une méticuleuse propreté et s’assit, découragé, sur le bord de la baignoire. Son regard balaya le carrelage et s’arrêta sur la corbeille à linge sale. Il espéra un instant y trouver l’explication de ces effluves tout en sachant qu’il ne laissait jamais attendre du linge de corps plus d’une demi-journée avant de le passer à la machine et que de toute façon, la capacité de nuisance d'un vieux torchon ayant éventuellement moisi entre le mur et la corbeille ne pouvait s’étendre à toute la maison, de la cave au grenier. Or, l’odeur s’insinuait partout, jusque dans les placards, y compris ceux de la chambre où il avait pourtant pris soin d’intercaler des tablettes et des boules en bois de cèdre imbibées d’huiles essentielles entre les piles de draps et les taies d’oreillers. Quant aux sachets de naphtaline suspendus aux cintres dans la penderie, leur relent désagréable mais rassurant se trouvait désormais absorbé, recouvert, vaincu par quelque chose de plus puissant, de plus insistant, de plus concentré. Lassé d'avoir déplacé son maigre corps dégingandé d’un escalier à l’autre, le nez en l’air, ayant humé halls et couloirs, flairé pitoyablement planchers et moquettes, fauteuils et vieux coussins, Earl Lediable ouvrit une fenêtre avec l’ultime idée, pourtant évidente et qu’il avait négligée : si rien ne pouvait puer à l’intérieur de son logement, cela pouvait venir de l’extérieur, sans doute de la zone industrielle où l’on ne se privait pas, de temps en temps, d’envoyer dans l’atmosphère quelques miasmes en toute impunité. Il respira l’air de la nuit mais n’y détecta rien d’autre que le parfum des feuillages d’automne. Il se souvint aussi que les puanteurs lâchées par les usines se déclinaient presque toutes dans une dominante de pisse de chat alors que ce qui lui emplissait en ce moment les narines évoquait plutôt la dégradation d’une puissante sueur. Il frémit alors à la pensée d’une présence étrangère dans la maison mais se rassura vite en se rappelant qu’il venait d’en inspecter chaque mètre carré. Sur la table de nuit, le cadran du réveil lui indiqua qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps pour dormir. Il s’allongea, remonta haut les couvertures, éteignit et renifla. L’air sentait vraiment mauvais. Étrange soirée ! Et ce chien sur le paillasson... Heureusement, il avait déguerpi et ce n’était pas cet animal qui avait pu ainsi empester toute la baraque puisqu’il n’y avait pas pénétré.
3
Le lendemain, Earl Lediable crut bien commencer la journée. La chambre s’emplissait de l’engageant arôme diffusé par la cafetière programmable et les rais de lumière filtrée par le store vénitien sur le mur blanc révélaient un matin clair. Plus aucune mauvaise odeur ne subsistait. Dehors, sur le chemin du bureau, le ciel s’assombrit très vite et Earl Lediable n’aima pas sa tête entrevue dans le rétroviseur d’un camion en stationnement. Le café n’avait pas suffi à le réveiller suffisamment pour qu’il puisse faire illusion sous le feu des regards hostiles de ses collègues qui le jugeaient mou et négligé. Il n’avait pas pris le temps de se raser afin de gagner quelques minutes de sommeil en plus après sa nuit écourtée. Au travail, il se fit encore un peu plus petit que d’habitude et compta les heures entre plusieurs stations prolongées aux toilettes. Peu après dix-huit heures, il ouvrait déjà sa porte, soulagé de pouvoir piétiner son paillasson sans en être dissuadé par l’animal qu’il considérait comme le plus répugnant de toute la création après l’homme : le chien.
4
Le soir, Earl Lediable consulta le programme de télévision et choisit un documentaire sur le sommeil. Comme il avait peu dormi la nuit précédente et qu’il s’était goinfré de charcuterie arrosée d’un épais vin rouge, il s’assoupit très vite devant l’écran. Lorsqu’il émergea de sa torpeur digestive, le documentaire montrait des dormeurs qui avaient été filmés pendant leur sommeil avec une caméra infrarouge et le résultat était effrayant. On les voyait s’agiter, se découvrir ou se dresser sur leur lit les yeux ouverts et le regard fixe. Certains se levaient et se déplaçaient avec frénésie dans la chambre dont ils cherchaient la porte pour sortir sans pour autant y parvenir car ils se trompaient de direction et se retrouvaient face au mur, loquetant dans le vide tels des idiots ou des fous. Déprimé par ces images, Earl Lediable éteignit le poste et se coucha en espérant ne pas mener la même sarabande nocturne que les dormeurs du documentaire. Le sommeil le prit et le projeta dans un rêve gigogne. « Je fais ce mauvais rêve parce que j’ai trop mangé », se disait-il au cœur de son rêve, « c’est ma faute, j’ai trop mangé, je suis le seul coupable... » et alors il rêvait qu’il ingurgitait des nourritures écœurantes et souillées, des viandes grouillantes d’asticots ou des fruits dans lesquels il mordait pendant que s’en échappaient de gros papillons aux corps velus. Haletant, il se réveilla en sursaut. Il avait cru entendre un grognement. Assis sur son lit, il tendit l’oreille le cœur battant. Des bruits étranges lui parvenaient sans qu’il puisse en déterminer la provenance. On aurait dit des pas très légers qui s’éloignaient puis se rapprochaient brusquement. Lorsqu’il voulut éclairer la lampe de chevet, l’ampoule grilla. Il saisit alors la lampe torche qu’il gardait dans la table de nuit en prévision des orages qui coupent le courant et entreprit de descendre au rez de chaussée. Dans l’escalier, il appuya sur l’interrupteur qui commandait deux ampoules dont aucune ne fonctionna. Le grognement, ce devait être le grondement d’un orage, et l’installation avait dû disjoncter. Il descendit l’escalier pour atteindre le hall où se trouvait le tableau électrique. D’une main il tenait la rampe et de l’autre il dirigeait le rayon de la torche. Arrivé en bas, il s’immobilisa un instant et écouta. Pas de tonnerre et pas d’éclairs mais de nouveaux bruits de déplacement, rapides, légers, impossibles à localiser. Balayant l’obscurité du faisceau de la torche, il marcha dans le hall d’entrée et ouvrit la porte de l’armoire électrique. Le disjoncteur était en position normale. Il commençait à réfléchir aux conséquences d’une panne sérieuse dans l’installation lorsqu’un choc retentit quelque part. Il braqua la lumière contre la porte d’accès au sous-sol où une salle de bain avait été aménagée. Il décida d’aller voir. Il en profiterait pour se passer un peu d’eau sur la figure. L’épouvante le paralysa dans l’escalier. Tout le sous-sol, occupé par une buanderie, une chambre d’amis, un couloir et la salle de bain, empestait le chien mouillé. L’odeur était aussi prégnante que si l’animal rôdait dans les parages. Un autre déplacement furtif se fit entendre. De frayeur, Earl Lediable lâcha la torche, trébucha dans l’escalier et faillit manquer les dernières marches après quoi il se précipita dans la salle de bain et tira le verrou.
5
La lumière matinale entrait par le soupirail donnant sur la rue. Earl Lediable se réveilla recroquevillé dans la baignoire et entreprit de se lever. Le téléphone sonnait au rez de chaussée. On devait déjà penser à tirer profit de son absence au bureau. Rassuré par le jour, il parvint au prix de quelques acrobaties à extraire son corps endolori de la baignoire. Il fixa quelques instants le verrou. Depuis le soupirail, il entendait passer des voitures dans la rue, ce qui l’encouragea à sortir de la salle de bain. Avant d’ouvrir, il pressa tout de même une oreille contre la porte et écouta. Puisqu’il n’entendait rien, il déverrouilla doucement et entrebâilla la porte. Le téléphone s’était arrêté de sonner. L’odeur de chien mouillé s’était dispersée mais il n’eut pas le temps de s’en réjouir. En montant l’escalier, il trébucha et sa main rencontra quelque chose qui traînait dans un recoin obscur, en bas d’une marche. Terrifié, il grimpa à toute vitesse jusqu’en haut de l’escalier, trébucha de nouveau et chuta la tête la première dans le hall où il examina en suffoquant ce qu’il tenait dans sa main, une touffe de poils de chien. Il demeura ainsi un moment, hébété de douleur, la lèvre fendue et la bouche en sang, puis il se leva brusquement, pris d’un accès de fureur, et se rua dans la cuisine où il saisit le grand couteau destiné à la découpe des viandes après quoi il pénétra avec frénésie dans toutes les pièces de la maison, bien décidé à débusquer le clébard et à lui mettre les tripes à l’air.
6
Lorsqu’il rentra chez lui, Earl Lediable estima qu’il fallait nettoyer de toute urgence. Le sous-sol ainsi que les marches de l’escalier étaient maculés de traces de sang séché. Malgré la fatigue que lui avait causé le trajet depuis le service des urgences de l’hôpital où on avait jugé qu’il était en état de regagner son domicile, il s’équipa d’un balai, d’une serpillière et remplit une bassine d’eau tiède dans laquelle il versa une dose de détergent. Il frotta le sol, essora la serpillière et recommença jusqu’à ce que le sang disparaisse. La tête lui tournait, ce qui le contraignit à interrompre son ménage. La vision de l’eau rougeâtre dans la bassine lui souleva le cœur. Il détourna les yeux et son regard s’arrêta sur une petite forme blanche, par terre, qui se confondait presque avec les plinthes. Une dent.
7
De violentes lueurs traversaient ses paupières closes et le goût du sang emplissait sa bouche. Earl Lediable se redressa, cracha une première fois, et s’allongea de nouveau. « On peut dire que vous vous êtes bien arrangé » commenta le dentiste. « Ce sera tout pour aujourd’hui. Devant, c’est plus compliqué. Il reste des morceaux d’incisive... Nous commencerons la semaine prochaine. » Earl Lediable n’avait plus qu’à rentrer se reposer mais il avait besoin de respirer et il fit un détour. Plus il s’éloignait du centre ville, moins les autos encombraient les trottoirs. Au coin d’une ruelle pavée, s’ouvrit brusquement la perspective d’une avenue déserte bordée de murs de brique. Le soleil couchant déchirait des pans de nuages mauves. Earl Lediable tendit la main vers un gros tronc de lierre dont les feuilles débordaient puis retombaient du côté de la rue. Un chat jaillit de ce chaos végétal et s’immobilisa sur le pilier d’un portail du haut duquel il souffla et feula. Plus loin, Earl Lediable longea un long mur de béton où était inscrit en immenses lettres noires AUTO-DÉMOLITION. Bientôt, la ligne droite de l’avenue se dispersa dans l’horizon du fleuve dont les quais suivaient le méandre. Frôlé par les ramures d’un vieux saule attaqué par mousses et lichens, Earl Lediable accéléra le pas. Une odeur chimique qui semblait provenir du fleuve le convainquit d’interrompre sa promenade. Il eut beau prendre un raccourci, il faisait déjà nuit lorsqu’il arriva devant sa porte. Il avait froid et mal aux dents mais un détail inhabituel le retint de tourner la clef dans la serrure. La fenêtre de la cuisine envoyait un halo de lumière sur le trottoir. Il s’approcha de la fenêtre et la première chose qu’il vit fut le reflet de son visage boursouflé et tuméfié. Il colla son front contre la vitre opaque de saleté et écarquilla les yeux en ouvrant sa bouche édentée. À l’intérieur, il vit ses amis qui s’esclaffaient, buvaient et s’empiffraient. Parfois, ils jetaient de gros morceaux de viande saignante au molosse qui bondissait la gueule béante pour les attraper et ils riaient encore à belles dents, sous les yeux inondés de larmes d’Earl Lediable atteint lui aussi par la contagion de ce rire enragé.
28 juillet 2020
Une nouvelle pour l'été
Amoureux trois quarts d'heure

Sylvain s’éloigna du groupe car il ne s’était pas trouvé seul depuis la veille. La lune éclairait le plateau et les seuls intermédiaires entre la voûte céleste et l’arrondi des prairies étaient les buissons de buis et de genévriers aux silhouettes tour à tour inquiétantes et rassurantes. Il marcha quelques instants dans l’herbe et retrouva vite le chemin qui descendait vers la forêt. Plus bas, le chemin s’élargissait en une route goudronnée qui serpentait jusqu’au-dessus de la bourgade où habitaient la plupart des filles et des garçons réunis ce week-end autour du feu de camps. Ceux qui avaient renoncé à la promenade nocturne continuaient de jeter dans le foyer de grandes brassées de genévrier.
Sylvain n’entendait plus crépiter les flammes qui s’élevaient avec les rires vers la voie lactée mais il flairait encore le parfum du feu. Lorsqu’il eut rejoint la route goudronnée, le silence et l’humidité des futaies l’enveloppèrent. Il avançait d’un pas régulier qui s’accordait bien avec le rythme de sa rêverie. Combien de temps marcherait-il ainsi ? Il n’en avait pas idée. De toute manière, il ne pouvait pas s’égarer puisque la route menait jusqu’à la ville et comme il n’avait pas l’intention de rentrer chez ses parents, il n’aurait qu’à faire demi-tour pour remonter au campement lorsqu’il le déciderait.
Déambuler seul dans la forêt en pleine nuit constituait une expérience inédite. Une nouvelle porte semblait s’ouvrir sur le monde. Ses camarades partageaient-ils la même sensation ? Bon nombre d’entre eux n’en étaient pas à leur premier feu de camps et avaient déjà l’habitude de sortir le soir pour aller faire la fête. Dans le groupe, quelques filles avaient déjà plus d’expérience et de maturité que lui.
La veille, tout le monde s’était donné rendez-vous à la sortie de la ville, en bas de la route qui montait au plateau. Certains s’accrochaient à deux par cyclomoteur, d’autres transportaient les provisions dans les sacoches de l’engin. Sylvain avait hérité d’un solide chargement de pain. Plusieurs garçons chevauchaient des bécanes aux couleurs des années soixante. Sylvain roulait quant à lui sur un Amigo jaune tout neuf qui semblait prêt à faire le tour de la planète.
Avec l’aide d’un grand frère qui venait d’obtenir son permis de conduire, les plus âgés du groupe avaient acheminé puis monté les tentes depuis deux jours. Ils n’étaient pas mécontents de voir arriver le reste de la troupe avec les victuailles. Après quelques bières, on relança le feu dès le crépuscule en déposant de l’épicéa et du genévrier sur les braises. Le grand frère était remonté faire un tour après avoir acheté des saucisses qu’on fit aussitôt griller. On arrosa les hot-dogs d’une piquette que l’air frisquet du plateau transforma en nectar. La fringale générale n’épargna pas une miette des baguettes pourtant réservées au petit déjeuner. Demain serait un autre jour.
Quelqu’un gratta l’éternelle guitare et le genièvre pétilla dans les flammes odorantes très tard dans la nuit. Presque tout le monde tomba d’accord pour une balade au clair de lune, excepté le grand frère et ses copains qui bossaient à l’usine à quatre heures du matin. Sylvain tenta d’imaginer quel effet cela pouvait faire de se retrouver à l’usine à quatre heures du matin après avoir passé une partie de la nuit à boire, manger et raconter des blagues autour d’un feu de sapin et de genévrier.
Maintenant, il marchait d’un pas régulier sur le goudron parfois soulevé par de grosses racines. De puissantes senteurs d’épicéa et de pin s’échappaient de cuvettes obscures et se dispersaient dans un léger souffle de brise qui retombait aussitôt. La forêt semblait se contenter de ces courtes respirations qui avaient à peine effleuré les chevelures des filles, tout à l’heure, autour du feu. Au début de sa promenade solitaire, Sylvain avait entendu leurs rires étouffés à mesure qu’il s’éloignait mais maintenant, le silence n’était rompu que par un froissement d’aile invisible ou le craquement d’une branche sèche. Pour se donner de l’assurance, il s’imprégna du quatrième mouvement de la septième symphonie de Mahler, l’andante amoroso « Nachtmusik » .
Peut-être avait-il marché trop loin, ce qui l’obligerait à remonter très tard au campement. Son seul désir était désormais de rejoindre le groupe qui devait déjà se reconstituer autour du feu. Sylvain regarda sa montre. Finalement, il n’avait pas pu marcher aussi longtemps qu’il en avait eu l’impression. Les autres étaient peut-être tout près, derrière quelques virages, un peu plus haut sur la route. Pourquoi n’était-il pas resté avec les filles, en particulier avec Prune qui lui avait souri quand leurs regards s’étaient croisés au moment d’allumer le foyer ? Le sourire espiègle de Prune, ses joues empourprées par la bonne chaleur du feu et le grand air, sa voix douce, quelle idée de préférer de solennelles rêveries à cette magie toute neuve... Que devait-elle penser de lui en cet instant ?
Cette route forestière moirée sous le clair de lune, ce paysage qui lui évoquait Verlaine, Laforgue, ces grands arbres qui berçaient encore sous leurs ramures les féeries de son enfance, tout n’était plus qu’un décor à l’abandon, un cahier interrompu aux premières pages. La vie était auprès de Prune, il devait se rapprocher d’elle, prononcer son prénom, Anita, et non pas ce surnom, Prune, qui lui venait d’on ne sait qui. Anita ! Anita ! Il allait l’appeler par son prénom et lorsqu’elle l’entendrait l’appeler « Anita ! » au milieu de la forêt, « Anita ! » , elle comprendrait qu’il la préférait, elle, bien sûr, si fraîche et lumineuse, si présente et chaleureuse, qu’il la préférait évidemment aux fantômes du monde ancien. Elle le saurait, elle en aurait la certitude, comme lui. Et les autres qui entendraient prononcer son prénom ne trouveraient rien à redire à une telle évidence. « Anita ! » Les autres ne s’étonneraient pas d’entendre la jeune fille lui répondre et l’appeler à son tour dans la nuit fantasque pour qu’il vienne enfin à elle dans le présent qu’elle incarnait et qu’il ne fallait pas manquer de vivre sans se poser trop de questions. Ce n’était pas bien compliqué, finalement. « Anita ! Anita ! »
Sylvain tressaillit et cessa d’appeler. Un virage un peu plus loin libéra une tache claire qui prit rapidement les contours d’une silhouette. Quelqu’un marchait à sa rencontre. Sylvain ne reconnut personne du campement. Il n’avait pas d’autre choix que de continuer d’avancer lui aussi. Dans la poche droite de son pantalon, il n’avait que son couteau suisse qu’il avait utilisé pour tailler de petites branches de bois sec.
Lorsque Sylvain put distinguer le visage de l’homme qui s’approchait, ils échangèrent un salut en même temps. L’homme s’arrêta puis repris son souffle. Il flottait dans un imperméable léger et Sylvain lui donna une cinquantaine d’années. Son expression semblait bienveillante. En restant à distance, l’homme dévisagea Sylvain avec intensité et déclara : « il y a du monde cette nuit dans la forêt. Je viens de croiser un groupe de jeunes gens. Des amis à vous peut-être ? » Sylvain se sentit soulagé. Les autres n’étaient pas loin. Ils l’avaient sûrement entendu appeler. « Je vais les rejoindre » dit Sylvain. « Bien sûr, jeune homme, rejoignez-les. » Et l’inconnu s’éloigna d’un pas lent.
Quelques minutes après, Sylvain retrouva les autres qui marchaient en direction du plateau en plaisantant. Un des garçons était bien éméché. Prune riait bruyamment à chacune de ses pitreries. Elle semblait un peu ivre elle aussi. On s’assit autour du feu qu’un copain cafardeux du grand frère venait de ranimer en y jetant de grosses ramures d’épicéa. On fit circuler un paquet de cigarettes. Le garçon éméché saisit la guitare et frotta les cordes avec une branche comme s’il jouait du violoncelle. Sylvain détourna les yeux et demanda aux autres si le type qui se baladait sur la route tout à l’heure leur avait dit quelque chose. « Un type ? Quel type ? On n’a vu personne. »
Prune eut un petit rire. Sylvain la dévisagea. Un coup d’œil à sa montre lui indiqua que d’après ses calculs, il avait dû être amoureux d’elle à peu près trois quarts d’heure.
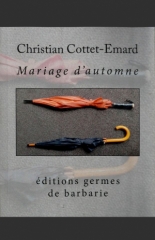
Nouvelle extraite de mon recueil Mariage d'automne, éditions germes de barbarie, 2017. Tous droits réservés © éditions Germes de barbarie 2017.
Pour Oyonnax et sa région, ce livre est disponible en prêt à la médiathèque municipale d'Oyonnax au centre culturel Aragon.
Une lecture de Mariage d'automne par Didier Pobel :
S'il fallait définir - quelle idée, on vous l'accorde! - les nouvelles de Christian Cottet-Emard, ce serait, disons, des traces. Traces de temps, traces d'amour, traces de vie. Quelque chose comme ces "grands rectangles clairs" laissés par les tableaux retirés d'un mur évoqués dans le sixième texte. L'intrigue a toujours la minceur d'un fil. Un barbecue noyé par l'orage sous lequel clapote "la ruine de nos existences". Les noces d'une amie où un invité chômeur, "pas à sa place", doute de son cadeau. Les manigances d'un étrange couple en Rolls verte. Les retrouvailles entre un vieil écrivain et une femme dont elle fut jadis brièvement l'amante...
Les protagonistes existent à peine. L'un d'eux s'adonne à la simple "observation de l'air", un autre se réconforte à la vue d'un forsythia au bord d'une voie ferrée. Il s'appelle Mhorn. Pas étonnant qu'il appartienne tout particulièrement à cette "morne confrérie de nouveaux nomades exilés" traversant ces proses aux volutes syntaxiques de cigare où affleure une mélancolie acidulée que ne renieraient ni Henri Calet ni Jules Laforgue en vadrouille à la fin du recueil.
Un ouvrage qui, quoique intitulé Mariage d'automne, pourrait bien offrir toutes les vertus d'une délicieuse lecture d'été. À l'ombre des "nuages lenticulaires". Ou au bord d'un lac bugiste. Instantanés, scènes intimistes. Côté court, Cottet jardin.
00:11 Publié dans Nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mariage d'automne, christian cottet-emard, éditions germes de barbarie, le fleix, périgord, aquitaine, blog littéraire de christian cottet-emard, feu de camps, guitare, forêt, nuit, étoiles, voûte céleste, fête, été, genévrier, sapin, cyclomoteur, honda amigo, braise, septième symphonie de mahler, nachtmusik, andante amoroso, épicéa, cigarettes, bière, vin, piquette, sandwich, saucisse, pain, baguette, tente, camping, usine, clair de lune, couteau suisse, paul verlaine, jules laforgue