16 août 2015
Étude de couverture pour Mariage d'automne
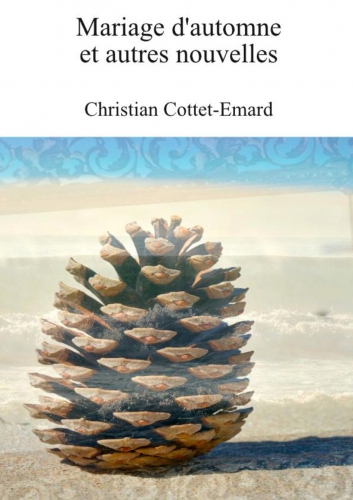
Édition numérique disponible ici :

Seize variations sur le thème du sentiment amoureux à travers les âges de la vie et les humeurs du moment.
Sommaire :
Mariage d’automne
Amoureux trois quarts d’heure
Bien le bonjour de l’adjudant Kaiser
Des pas dans la nuit
Éclaircies
Grandes fêtes sous la lune
Beignets ! Qui veut des beignets ?
La Rolls verte
La photocopieuse
Rendez-vous à Pré Nuble
Feuilles mortes et pages décollées
Le vieux pull
Passage d'un vivant
Le jour où la vérité s’invita au barbecue
Au Bazar des Hirondelles
Figures libres, couple
|
00:36 Publié dans Nouvelles | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : mariage d'automne, amazon kindle, livre numérique, christian cottet-emard, nouvelles, littérature, fiction, blog littéraire de christian cottet-emard, amoureux trois quarts d'heure, bien le bonjour de l'adjudant kaiser, des pas dans la nuit, éclaircies, grandes fêtes sous la lune, beignets ! qui veut des beignets ?, la rolls verte, la photocopieuse, rendez-vous à pré nuble, feuilles mortes et pages décollées, le vieux pull, passage d'un vivant, le jour où la vérité s'invita au barbecue, au bazar des hirondelles, figures libres couple, droits réservés, fiction romanesque
04 août 2015
Carnet / Réac
Au rayon livres de l’Uniprix du coin, un titre qui retient mon regard : Du bonheur d’être réac de Denis Tillinac. Envie de lire ce petit livre. Je le trouverai facilement en occasion. Je n’achète les essais et les témoignages (vite périmés) qu’en occasion ou en poche mais je suis bien de l’avis de Tillinac même si je suis loin de ses amitiés politiques, être réac, quel bonheur !
 Ah les mines déconfites à l’apéritif ou pendant le dîner quand vous lâchez d’une voix calme et l’air distrait deux ou trois saillies bien réacs en plein milieu des embrasseurs d’arbres, des dormeurs en yourte, des écolos décathlon, des retraités quechua, des quinquas en crise d’ado, des islamo-gauchistes, des voisins en fête, des engagés dans la vie locale, des adorateurs du Che, des citoyens du monde, des pierrerabiens planant sur colibri, des mâchouilleurs de pain noir, des opposants au ruban à glue et à la tapette à mouches, de ceux qui ont de l’empathie pour tout le monde mais pour personne en particulier et toute l’armée des militants qui feront votre bonheur de gré ou de force...
Ah les mines déconfites à l’apéritif ou pendant le dîner quand vous lâchez d’une voix calme et l’air distrait deux ou trois saillies bien réacs en plein milieu des embrasseurs d’arbres, des dormeurs en yourte, des écolos décathlon, des retraités quechua, des quinquas en crise d’ado, des islamo-gauchistes, des voisins en fête, des engagés dans la vie locale, des adorateurs du Che, des citoyens du monde, des pierrerabiens planant sur colibri, des mâchouilleurs de pain noir, des opposants au ruban à glue et à la tapette à mouches, de ceux qui ont de l’empathie pour tout le monde mais pour personne en particulier et toute l’armée des militants qui feront votre bonheur de gré ou de force...
Le nec plus ultra : leur siffler sous le nez toute la bouteille de vin bio et les finir avec un cigare bien brutal !
02:03 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : réac, du bonheur d'être réac, denis tillinac, carnet, note, christian cottet-emard, prairie journal, autobiographie, écriture de soi, journal, blog littéraire de christian cottet-emard, littérature, essai, cigare, vin bio, tapette à mouches, ruban à glue
29 juillet 2015
Une expérience :
Disponible ici

Présentation de l'éditeur
Seize variations sur le thème du sentiment amoureux à travers les âges de la vie et les humeurs du moment.
Sommaire :
Mariage d’automne
Amoureux trois quarts d’heure
Bien le bonjour de l’adjudant Kaiser
Des pas dans la nuit
Éclaircies
Grandes fêtes sous la lune
Beignets ! Qui veut des beignets ?
La Rolls verte
La photocopieuse
Rendez-vous à Pré Nuble
Feuilles mortes et pages décollées
Le vieux pull
Passage d'un vivant
Le jour où la vérité s’invita au barbecue
Au Bazar des Hirondelles
Figures libres, couple
Détails sur le produit
|
01:07 Publié dans Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mariage d'automne, amazon kindle, livre numérique, christian cottet-emard, nouvelles, littérature, fiction, blog littéraire de christian cottet-emard, amoureux trois quarts d'heure, bien le bonjour de l'adjudant kaiser, des pas dans la nuit, éclaircies, grandes fêtes sous la lune, beignets ! qui veut des beignets ?, la rolls verte, la photocopieuse, rendez-vous à pré nuble, feuilles mortes et pages décollées, le vieux pull, passage d'un vivant, le jour où la vérité s'invita au barbecue, au bazar des hirondelles, figures libres couple, droits réservés, fiction romanesque





























