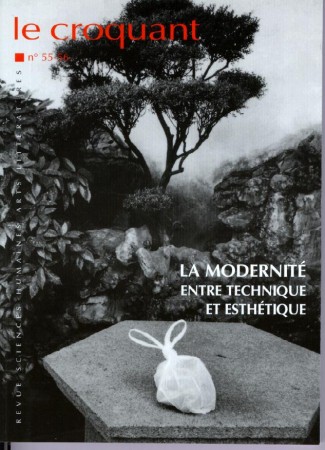22 décembre 2007
Les élèves organistes d’Oyonnax visitent l’orgue de Fourvière
Le programme des visites d’orgues proposées par Véronique Rougier qui enseigne cet instrument à Oyonnax s’est terminé cette année par une journée à la basilique de Fourvière à Lyon.
Les élèves organistes d’Oyonnax se sont succédé samedi 15 décembre à la tribune de l’orgue Charles Michel-Merklin datant de 1896, un bel exemple d'orgue symphonique.
Le groupe était reçu par Yves Lafargue, organiste titulaire de Notre-Dame de Fourvière, titulaire à la primatiale Saint-Jean de Lyon, professeur du CNR de Lyon, concertiste et compositeur de pièces d’orgue, de pièces vocales et de musique liturgique.
Photo : Yves Lafargue avec Véronique Rougier (au premier plan), Clara Cottet-Emard aux claviers, et Sophie Pesnel-Muller.
00:49 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Musique, orgue, Véronique Rougier, Yves Lafargue, basilique Fourvière, Classe d'orgue, Oyonnax
10 décembre 2007
Le Croquant et la modernité
Le Croquant n° 55-56, qui a pour thème La modernité, vient de paraître. Plutôt que d’en livrer ici une note de lecture puisque j’y participe, je préfère citer des extraits de deux passionnantes contributions, celle de Joël Clerget et celle de Jean-William Lapierre quant à lui décédé à la veille de l’été 2007 et à qui Michel Cornaton, directeur du Croquant, et Edgar Morin rendent hommage dans cette édition.
La photographie de couverture est signée Marc Riboud.
La modernité sans images (Joël Clerget, psychanalyste, écrivain, Lyon) :
« L’immoralité de notre modernité n’est pas sexuelle, elle est économique. La lutte des « intermittents du spectacle » nous a fait percevoir à quel point l’ignardise politique des gouvernants est impropre à résoudre quelque problème social que ce soit. Même les employés des casinos firent grève le 31 décembre 2006, craignant d’être, entre autres, remplacés par des machines. Des machines à sous sans doute. Que la machine soit mise à la place de l’homme n’est pas encore le pire scandale, mais que l’homme soit fait machine lui-même, robotisé, est humainement inacceptable. Les métiers de relation sont désormais imprégnés de ce machinisme impénitent. On nous fait devoir de réparer les pannes, casses et autres accidents de cette constante production de l’oppression généralisée. L’on ne compte plus les suicides... »
La modernité, tarte à la crème de l’idéologie dominante (Jean-William Lapierre, sociologue) :
« Aujourd’hui, la modernité est la tarte à la crème de l’idéologie dominante. Quels sont les ingrédients de ce produit de la propagande politique et de la publicité ? J’en vois quatre mais ne prétends pas être exhaustif. Le premier est l’économisme. Quand il y avait des marxistes, on leur reprochait souvent de tout fonder sur l’infrastructure économique. Mais ils reconnaissaient tout de même une « autonomie relative » aux superstructures politique et idéologique. Le triomphe mondial du libéralisme économique (à ne pas confondre avec le libéralisme politique) a mis fin à cette autonomie relative. Dans l’idéologie actuelle de la modernité, tout (la politique, l’ethnique, l’art, la recherche scientifique, la médecine, la culture, l’information) est subordonné voire réduit à des considérations et des objectifs économiques, ceux des détenteurs du pouvoir économique. »
« Nous avons connu au XXe siècle des idéologies dont la domination était « hard » (comme on dit en franglais moderne) : le fascisme, le nazisme, le stalinisme imposaient leur domination par la répression, le bourrage de crâne, l’exaltation des foules. La domination de l’idéologie de la modernité est insidieuse, latente, « soft ». Dans un entretien à Télérama (29 juin 2005, p. 25-26) le sociologue polonais Zygmunt Baumann (que j’ai rencontré lors d’un séminaire à Varsovie en septembre 1958, et qui est devenu professeur à Tel-Aviv et Leeds) dit : « (qu’en) quelques années, les forces dominantes, qui détiennent l’argent et le pouvoir d’organiser le monde dans leur intérêt, ont trouvé d’autres stratégies plus légères, moins contraignantes ». Mais efficaces : le contrôle technocratique des moyens d’information et de communication, des institutions (en particulier de l’enseignement), le financement des campagnes électorales des politiciens, la pression des « lobbies », la précarité des emplois (« n’est-elle pas, demande Baumann, une formidable manière d’obtenir l’ordre et la soumission ? ») et surtout le contrôle de nos pratiques quotidiennes de consommation par la publicité, de nos loisirs par la « télé-réalité ». Baumann encore : « Que nous apprennent ces émissions ? Que chacun est toujours seul face à tous, que la société est un jeu pour les durs. Ce qui est mis en scène, c’est la jetabilité, l’interchangeabilité et l’exclusion. Il est inutile de s’allier pour vaincre puisque tout autre, au bout du compte, ne peut être qu’un adversaire à éliminer... Quelle métaphore de la société ! ».
Revue Le Croquant (sciences humaines, arts, littératures), 208 pages, 20 euros (port non compris).
mail : revuelecroquant@yahoo.fr
23:48 Publié dans Et à part ça ? | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Revue Le Croquant, la modernité, débat, idée, sciences humaines, arts, littératures
08 décembre 2007
Daniel Biga à Ambérieu (Ain) le 14 décembre 2007
 Martin Laquet me communique l’annonce de la prochaine soirée de Poésie vive dont je relaye bien volontiers l’information.
Martin Laquet me communique l’annonce de la prochaine soirée de Poésie vive dont je relaye bien volontiers l’information.
Poésie Vive invite Daniel Biga le vendredi 14 décembre 2007 à la Médiathèque La Grenette, 8 bis, rue Amédée Bonnet à 19h30 à Ambérieu-en-Bugey. Entrée libre.
Daniel Biga est né en 1940, à Nice. Il vit à Nantes où il dirige la Maison de Poésie.
Il a publié une trentaine de livres.
Il souscrit toujours pleinement à la « non définition » de son ami Robert Filliou :
« L’art c’est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. »
Daniel Biga, c’est le Monsieur Loyal de la scène poétique.
En effet à la Maison de la Poésie de Nantes qu’il a dirigée pendant 6 ans, il a reçu et fait connaître tous les poètes-écrivains de France et de Navarre. Et la revue maison, Gare maritime, a fait ainsi de Nantes un haut lieu d’apparition, d’échange et de diffusion de la parole de création.
Il est né à Nice en mars 1940. Grâce au petit Sauvage des Quatre-Chemins, son autobiographie dont il lira quelques extraits, nous revivons les années noires mais aussi le retour aux activités de paix, l’élan d’enthousiasme et la foi en le progrès. Ceci dans un milieu rural de mas, bastides et villages provençaux où le garçon naïf découvre - émerveillé ou horrifié - sa présence au monde et la complexité de vivre…
« Le poète ne cotise pas à la sécurité sociale »
Dans Le poète ne cotise pas à la sécurité sociale, une anthologie personnelle qui rassemble 40 ans d’écriture, il évoque la lutte sans merci avec la chair des mots, où le vocabulaire le plus cru, les plus subtils raffinements du langage se confrontent aux interdits et à la morale. Vérité et provocation. Daniel Biga a été présenté comme « le seul poète rescapé de Mai 68 », un poète capable de passer d’un bricolage à la Andy Warhol au plus concentré des gestes de méditation.
Une soirée en partenariat avec l’Espace Pandora (Vénissieux).
23:05 Publié dans Et à part ça ? | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Poésie, poésie vive, Daniel Biga, médiathèque, Ambérieu, Ain, Martin Laquet