16 juin 2007
Le sourire de Cézanne
 Le sourire de Cézanne, Raymond Alcovère, roman, éditions n&b, 2007, 105 p.
Le sourire de Cézanne, Raymond Alcovère, roman, éditions n&b, 2007, 105 p.
Je n’ai jamais rencontré Raymond Alcovère mais la lecture de ses nouvelles, publiées dans la revue Salmigondis, et la fréquentation quotidienne de son blog (http://raymondalcovere.hautetfort.com) m’ont rapidement révélé l’évidence d’une nouvelle découverte littéraire, confirmée par la toute récente publication de son deuxième roman, Le sourire de Cézanne, par le même éditeur qui avait publié le premier, intitulé Fugue baroque, Prix 1998 de la Ville de Balma.
Sur la trame d’un amour entre Gaétan, étudiant de vingt ans, et Léonore, quarante ans, en pleine rupture sentimentale, le texte se déploie en une riche variation sur les thèmes de la peinture, du regard, avec en filigrane la question de la maladie d’Alzheimer dont est atteint le père de Léonore. La rencontre en mer de ces deux êtres à la recherche d’un nouvel élan aurait pu se limiter à une banale aventure s’ils n’étaient tous deux portés par une intense soif de beauté et de liberté qui ne peut s’épanouir que dans le dialogue permanent entre l’art et la vie.
Dans cette nouvelle traversée, Léonore tente de renaître dans l’écriture d’un livre sur les peintres et par l’appétit de vivre de son jeune allié, arrivé lui aussi à un carrefour de son existence. Gaétan et Léonore sont à l’heure du choix : l’oubli d’eux-mêmes, dans la futilité pour Gaétan et dans les deuils pour Léonore, ou le consentement à une nouvelle présence au monde. Pour avancer dans ce choix, il leur faudra savoir rester attentifs aux signes des forces de vie nées d’un regard d’artiste ou de l’ultime sourire d’un père.
À ce premier niveau de lecture, les fervents de la dimension romanesque seront déjà comblés. Mais l’art de Raymond Alcovère (qu’on pourrait, je le dis au passage, qualifier de coloriste dans sa merveilleuse manière de décrire les ciels) saura aussi les entraîner beaucoup plus loin, par la grâce d’une écriture harmonieuse, épurée, au rythme élégant et soutenu.
C’est cette fluidité de style qui permet à Raymond Alcovère de développer, en contrepoint, ses variations sur un thème qui lui est cher, la peinture, en particulier celle de Cézanne cité en ouverture : « Pourquoi divisons-nous le monde ? », interrogation cruciale pour Léonore et Gaétan dans leur aspiration à un accord sinon parfait mais pacifié, tant dans la dimension intime de leur amour que dans celle de leur environnement extérieur.
Cette quête d’unité dans un rapport harmonieux au monde qui réunit Léonore et Gaétan, Raymond Alcovère la suggère en évoquant ses peintres préférés par petites touches ponctuant le récit de courtes parenthèses d’une subtile érudition. Le lecteur se retrouve ainsi plongé en quelques notations en apparence improvisées dans l’univers de Cézanne mais aussi de Gréco, Vélasquez, Rembrandt, Caravage, Rubens, Delacroix, Picasso, Titien, Poussin, Miro, Zao Wou Ki...
Raymond Alcovère sait si bien partager son amour de la peinture qu’on pourrait conseiller la lecture de son roman à qui veut s’initier à l’approche esthétique des grands artistes, seuls capables de modifier notre regard sur nous-mêmes et sur le monde.
L’alliance du romanesque et du commentaire artistique éclairé fait en tous cas de cette belle histoire d’amour qu’est Le sourire de Cézanne une oeuvre d’une grande fraîcheur et d’une vitalité communicative, qualités littéraires aujourd’hui assez rares pour être soulignées.
20:25 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Roman, littérature, Cézanne, peinture, Raymond Alcovère, le sourire de Cézanne
12 juin 2007
Qui a peur de René Char ?
 (Notes pour un article)
(Notes pour un article)
« Char, Les Fontaines, ça se touche.»
(Georges L. Godeau)
À la fin des années soixante-dix du siècle dernier, les poètes se retranchent entre les laboratoires universitaires et les arrière-salles de bistrots. Point d’autre salut pour la poésie passée à la moulinette de la linguistique ou, à l’opposé, de la banalité revendiquée comme un des beaux arts. Résultat, un petit air de renfermé et, pour beaucoup de lecteurs, une aspiration au grand large. La solution existe déjà à cette époque : René Char.
Comment lire Char ? Étrange et récurrente question. Demande-t-on ou se demande-t-on « comment lire » les autres grands poètes, notamment ses plus illustres contemporains ? Faut-il prendre Char avec des pincettes ? Est-il vraiment ce poète réputé ardu dont les nombreux commentateurs tentent parfois de se mettre au diapason en produisant des analyses et des études qui n’ont rien à envier à l’obscurité qu’on reproche à une partie de sa poésie ? Qui a peur de René Char ?
Georges Mounin, professeur de linguistique, ami proche de René Char et auteur de Avez-vous lu Char ? (Folio essais) écrit quant lui dans sa postface au recueil Avec René Char du poète Georges L. Godeau (Le Dé bleu éditeur) : « il ne faut jamais oublier, je crois, que la poésie la plus forte de René Char est probablement, non pas dans ses oracles si difficilement déchiffrables, mais dans ses poèmes les plus directs et les plus nus, Congé au vent, L’amoureuse en secret, Rémanence, et tant d’autres. » J’ajouterais quant à moi, dans les poèmes qui accompagnent une vie entière, La Sorgue (chanson pour Yvonne) et La Complainte du lézard amoureux, somptueusement mis en musique par Pierre Boulez (Disque Erato).
En 1991, lors de ma seconde rencontre avec le poète Jean Tardieu, nous parlons de ses contemporains, Ponge, Follain, Jaccottet... Char aussi, « plus difficile à fréquenter car il vivait retiré à l’Isle-sur-Sorgue » précise Tardieu en ajoutant : « Certains y voient un monument d’hermétisme, moi je ne trouve pas. Dans cette concision aphoristique, il y a quelque chose qui ne peut que mûrir et donner maintenant ou plus tard quelque chose de comparable aux grandes oeuvres classiques - Pascal, Chamfort, Joubert - une façon de vivre, un prophétisme. Cette poésie cessera de paraître inaccessible. D’ailleurs, je suis convaincu que l’on vivra de plus en plus en poésie : avec l’effondrement des idéologies, il y a désormais une place pour la poésie comme ressource salvatrice, protectrice de l’esprit. »
Difficile de rêver meilleur encouragement à entrer dans l’oeuvre de René Char, surtout en ce début de 21ème siècle à la grisaille boutiquière que Char n’a pas connu mais dont il a pressenti et annoncé de son verbe haut les dérives et les menaces dès le début de sa résistance aux ténèbres du siècle précédent. Sa déception, à la fin de la guerre, de voir l’utopie céder tout de suite devant les arrangements et les compromissions qui contribuèrent à poser les fondements de la nouvelle société d’après le désastre, est à la mesure de l’énergie déployée lors de son engagement total dans la Résistance.
Résistance. Un mot dont on ne peut faire l’économie lorsqu’on évoque la vie et l’oeuvre de René Char, bien au-delà des années de lutte clandestine, bien avant et bien après la confrontation directe, violente, à l’abjection du nazisme puisque cet esprit de résistance a pour socle la poésie.
Dès les premiers poèmes publiés, en revues comme en volumes, dès Les Cloches sur le coeur, premier recueil imprimé à compte d’auteur en 1928 puis détruit par Char, la voix est posée : tendue, puissante, complexe, et elle restera la même, immédiatement identifiable parmi toutes les autres, y compris celles de ses compagnons surréalistes auxquels, contrairement à Char, on ne fait pas systématiquement reproche d’obscurité, d’hermétisme.
Hermétique cette poésie ? Obscurs, certains textes le sont, ni plus ni moins que ceux des autres poètes surréalistes ou même de leurs contemporains adeptes d’une langue plus classique tels que Ponge, Tardieu... Et je ne parle pas des deux générations suivantes dont les jeux formels, recherches et autres expériences congédient encore bien des lecteurs, à tel point que ces derniers n’associent plus aujourd’hui au mot poésie que l’image d’une vieille serrure grippée dont la clef aurait été jetée depuis belle lurette. Que ces lecteurs reviennent à Char et ils retrouveront cette voix de la poésie, ce souffle, cette ampleur - même dans l’aphorisme -, ce timbre qui manquent à tant de poèmes publiés de nos jours et qu’on croirait tous alignés par le même auteur. Et si cette voix dérape parfois dans quelques solennités indéchiffrables, n’oublions pas à quelle personnalité d’exception elle appartient et à quels terribles moments de l’Histoire elle parle (ou se tait).
Tout d’abord, Char a été surréaliste et il s’est exprimé comme tel, c’est-à-dire peu soucieux de lisibilité immédiate. Sa poésie en restera toujours marquée, même après sa prise de distance avec un mouvement en proie aux dissensions personnelles, politiques et esthétiques. Ensuite, la guerre, la défaite, la collaboration puis la guerre froide instaureront un climat propice à la prolifération de « la fausse parole » pour reprendre le titre du fameux livre du poète Armand Robin (éditions Le Temps qu’il fait). On peut penser que l’hermétisme de Char, héritage du surréalisme lui-même né de Dada vomissant les « valeurs » conduisant aux hécatombes de la première guerre mondiale, s’inscrit dans le réflexe de cette « ressource salvatrice de l’esprit » évoquée par Tardieu. On notera en outre qu’en Italie, entre 1940 et la fin de la guerre, le poète Mario Luzi incarnera aux côtés d’autres poètes tels que Bigongiari, Parronchi et Gatto, l’hermétisme florentin dont la langue poétique s’affirme, par le refus de la lisibilité immédiate, comme une résistance à l’omniprésent discours fasciste. Dans le même temps, la décision de Char de ne rien publier pendant la lutte, de mettre sa poésie « en veilleuse », de se limiter à l’écriture des notes de calepin qui deviendront les Feuillets d’Hypnos, tout cela atteste de ce même réflexe de résistance à la brutalité et à la barbarie qui étendent leur pouvoir de corruption jusqu’au coeur du langage. Dans cette période d’affrontement et de danger, Char a plus que jamais besoin de soustraire la parole poétique à ce qui tend à la réduire, à la fausser, à la trahir, à la détruire. Il ne peut donc parler la langue rudimentaire de l’engagement, de la poésie embrigadée, même au service d’une juste cause.
Une fois le nazisme vaincu et la guerre finie, Char ne baisse pas pour autant la garde et c’est en poète à la langue toujours en tension qu’il voit sans doute se profiler les nouveaux périls dont Pasolini résumera plus tard la nature : « Le véritable fascisme, c’est le pouvoir destructeur de la société de consommation » ou encore : « ce nivellement culturel auquel le fascisme n’avait pu parvenir en vingt ans, la civilisation du bien-être l’a obtenu en quelques années seulement. Nous sommes tous morts, et pourtant, nous ne le savons pas encore.» Dans ce contexte, Char ne peut se contenter du recours à une langue poétique apaisée ou relâchée. (« L’ennemi le mieux masqué du poète est l’actualité », écrira-t-il). Char s’exprime toujours avec la langue en tension de la poésie, qu’il publie, qu’il s’entretienne avec ses proches dans sa correspondance privée ou qu’il s’adresse en public à ses concitoyens ainsi qu’il avait coutume de le faire au moyen d’affichages s’il le jugeait nécessaire. On le voit par exemple dans ce texte (La Provence point oméga) imprimé sur une affiche dessinée par Picasso, lors de son engagement contre l’implantation des silos de missiles nucléaires au plateau d’Albion : « Que les perceurs de la noble écorce terrestre d’Albion mesurent bien ceci : nous nous battons pour un site où la neige n’est pas seulement la louve de l’hiver mais aussi l’aulne du printemps. Le soleil s’y lève sur notre sang exigeant et l’homme n’est jamais en prison chez son semblable. À nos yeux ce site vaut mieux que notre pain, car il ne peut être, lui, remplacé. » Si de telles images ne traversent pas tous les jours la poésie dite « engagée », on conçoit que le grand public destinataire du message ait pu les trouver bien sibyllines. Cela indique qu’il faut évoquer l’existence d’une dimension ésotérique plutôt qu’hermétique dans la parole poétique de René Char. Du registre de l’ésotérisme à celui du merveilleux, il n’y a qu’un pas mais Char affirme ne pas le franchir.
Que dire alors à qui se présente au seuil de cette oeuvre ? Comment transmettre l’énergie reçue dans cette lecture qui est aussi une expérience sans se laisser désarçonner par la récurrente objection d’hermétisme, de difficulté voire d’obscurité ? Réaffirmer d’entrée qu’on est en poésie et qu’aucune poésie, même la plus immédiatement accessible, ne laisse le lecteur tranquille dans ses petites habitudes. Et puisqu’il faut des repères, ne pas hésiter à en donner. De la Sorgue au Mont Ventoux, dans ce pays de fontaines toutes reliées à la plus prodigieuse (la résurgence du gouffre dont Char disait en commentant une photo de son enfance : « on ne pouvait pas m’arracher au trou »), ne manquent pas les clefs d’or et de fer, d’éclat et de rouille, semées à la volée pour ouvrir les portes du merveilleux. Car le merveilleux est bien présent dans la poésie de René Char, même si le poète réfute le terme et même si cette petite porte d’accès à sa poésie est négligée dans de nombreuses études parfois arides qui ne rendent pas toujours service, dans leurs hommages amphigouriques, à une oeuvre pouvant très bien se passer de commentaires. « Il faut trouver le chemin de la poésie. Tout écrit sur elle est inutile. » assène Char.
Dans sa pleine maturité, devenu un poète reconnu, Char s’est vu frôlé par le chalut du structuralisme et de la linguistique dont il s’est d’emblée tenu à distance ainsi qu’on peut le lire dans une correspondance citée par Laurent Greilsamer dans sa biographie L’Éclair au front (éditions Fayard) : « Cette sorte d’activisme ne mène, à mon avis, à pas grand-chose. Nous ne sommes pas cela. Et si nous le sommes, ce ne peut être qu’un faible volume du corps fuyant de la poésie qui nous compose. Il est possible que les robots futurs voués au décuvage subtil des poèmes procèdent de cette façon. Ce n’est pas, certes, la meilleure, de traiter par les acides la nourriture poétique...» Irréductible Char !
Ce merveilleux dénué de toute mièvrerie, Char le compose avec ce qu’il a sous la main, la Sorgue lumineuse, le petit peuple de ses rives avec ses vagabonds, braconniers, rêveurs, autant de personnages humbles ou hauts en couleurs, réels ou en partie imaginaires qu’il nomme les Transparents et qui parcourent les sentiers aromatiques, frôlent les murets de pierre sèche et alertent les lézards. Char qui alterne les séjours dans sa province et dans la capitale, convoque aussi les hasards et les mystères de la grande ville.
Alors, avec ce matériau souvent plus simple qu’on ne l’imagine, parfois même assez rustique, pourquoi la poésie de Char est-elle perçue comme si difficile à déchiffrer ? C’est que cette poésie n’est pas à déchiffrer. On l’accepte ou on la refuse. Pas de demi-mesure. Mais il est vrai aussi que cette poésie ne nous invite pas pour autant dans son intimité. Le poème de Char veut nous parler mais sur une fréquence que le lecteur doit trouver par ses propres moyens, et qui n’est ni celle de la confidence ni celle de l’oracle. Que les amateurs de rébus passent également leurs chemin. S’ils persistent, ils joueront les philologues égarés dans un univers auquel ils n’auront, au bout de tous leurs efforts, point accès, comme ils s’exposeront à ne trouver en René Char qu’un « laborieux fabricant de devinettes biscornues et de solennités boursouflées » ainsi que le qualifie François Crouzet dans un pamphlet drôle à lire mais qui ne parvient pas à atteindre complètement sa cible (Contre René Char, éditions Les belles lettres, 1992). En même temps, il est bien qu’on puisse aujourd’hui lire Char en liberté, Char délivré de la gangue de sa statue de commandeur. Aussi ce pamphlet côtoie-t-il dans ma bibliothèque les ouvrages qui permettent de se repérer dans l’univers du poète, notamment les beaux livres publiés par Marie-Claude Char après la mort de son mari, Faire du chemin avec René Char (Gallimard), Dans l’atelier du poète (Gallimard Quarto), et Pays de René Char (Flammarion) auxquels il faut ajouter l’étrange essai de Paul Veyne René Char en ses poèmes (Gallimard). Une curiosité ! Paul Veyne a développé avec Char une relation complexe, orageuse, mêlant admiration, amitié et... décryptage !
Mais c’est d’une minuscule plaquette, presque invisible entre ces forts volumes, que je veux extraire une citation en forme de conclusion à ces quelques notes éparses sur ma lecture personnelle de René Char. Ce mince livret du poète Georges L. Godeau intitulé Avec René Char (Le Dé bleu éditeur) se compose de douze petites proses poétiques relatant la rencontre de l’auteur avec le riverain de la Sorgue :
« René Char m’a offert une canne en buis. Je l’ai clouée chez moi en face de mon bureau. Plus je la contemple, moins je ne puis écrire. Hier, je l’ai mise sur l’armoire. L’araignée l’a parcourue en zigzag puis a tissé autour quatre épaisseurs de toile comme pour arrêter quelque chose. Assise maintenant au fond, elle m’observe de son oeil noir. Pardi ! »
Ce recueil de vingt-quatre pages, imprimé un an après le décès de Char survenu le 19 février 1988, convie mieux que toute glose le lecteur au seuil de cette oeuvre aux mille entrées. La rencontre dont témoigne cet opuscule est beaucoup plus que celle de deux poètes. Elle est celle, éternellement renouvelée, du poème et de son lecteur car, ainsi que l’affirme René Char, « le poème est toujours marié à quelqu’un.»
© Christian Cottet-Emard et Orlag presse. Droits réservés.
20:05 Publié dans Et à part ça ? | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : rené char, poésie
28 mai 2007
Réponse au questionnaire des quatre...
Cher Jean-Louis Kuffer
J'ai bien peur que Christophe Cottet-Emard ne soit pas en mesure de répondre au terrible questionnaire. C'est donc Christian qui s'y colle et qui vous passe le bonjour.
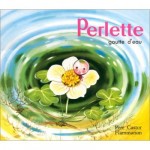 * Les quatre livres de mon enfance :
* Les quatre livres de mon enfance :
- Perlette goutte d’eau de Marie Colmont, éditions Flammarion, collection Père Castor, (les aventures d’une goutte d’eau qui a peur de quitter son nuage et qui y retourne après son voyage sur Terre).
- Sylvain et Sylvette de Maurice Cuvillier (en voilà deux qui savent se débrouiller dans la vie !).
- Les séries Club des cinq et Clan des sept d’Enid Blyton, bibliothèque rose. (Fascinant pour un enfant solitaire).
- Tistou les pouces verts de Maurice Druon, bibliothèque rouge et or souveraine. (Pour l’atmosphère du conte plus que pour l’histoire de ce garçonnet au don étrange).
* Les quatre écrivains que je lirai et relirai encore :
Parmi beaucoup d’autres :
- Vladimir Nabokov (pour la magie).
 - Jean Tardieu, avec sa voix dans la tête (Photo ci-contre).
- Jean Tardieu, avec sa voix dans la tête (Photo ci-contre).
- Albert Cossery (le dernier aristocrate).
- Fernando Pessoa (mon plus grand choc poétique).
* Les quatre auteurs que je ne lirai plus jamais
Parmi les très nombreux :
- Probablement Philippe Djian (tant qu’il persistera dans son industrie).
- Jean-Chrispophe Rufin (je voulais comprendre comment un lecteur fin et avisé de ma connaissance avait pu trouver de l’intérêt à cette boursouflure qu’est Rouge Brésil).
- Alain Bosquet (René Char l’a magistralement remis à sa place).
- Saint-Exupéry (tout ça pour du courrier...).
* Les quatre premiers livres de mes prochaines lectures
- Le lieutenant Kijé et autres récits de Iouri Tynianov (j’ai déjà lu le lieutenant Kijé mais pas encore commencé les autres récits réunis dans le volume de l’Imaginaire / Gallimard). C’est la musique de Prokofiev qui m’a amené à cette histoire d’officier fantôme créé par une faute d’orthographe dans un registre administratif).
- Les chroniques de ma vie d’Ygor Stravinsky, éditions Denoël.
- La vitesse foudroyante du passé (poèmes) de Raymond Carver, éditions de l’Olivier, (besoin de respirer un autre air que celui de la « poésie » qui se bricole aujourd’hui en France.
- L’enfant et la rivière d’Henri Bosco, Folio, (que je vais relire pour la énième fois).
* Les quatre livres que j’emporterais sur une île déserte
- La Pléiade de René Char (tant pis si ça l’esquinte).
- Le dictionnaire amoureux de Venise de Philippe Sollers, éditions Plon, (pour me rappeler mes séjours vénitiens et ce qu’était la civilisation).
- Le guide des arbres et arbustes d’Europe d’Archibald Quartier (texte et cartes) et Pierrette Bauer-Bovet (illustration), éditions Delachaux & Niestlé. (Pour lutter contre le mal du pays).
- Le petit guide panoramique des fruits sauvages (zone tempérée de l’Europe) de Robert Quinche (texte) et Martha Seitz (illustration), éditions Delachaux & Niestlé. (Pour me rappeler mes promenades dans la campagne).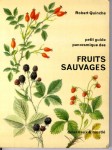
Et si je ne devais pas pouvoir quitter l’île pendant longtemps, je demande d’avoir droit à un cinquième livre :
- Le guide des fleurs sauvages (zone tempérée de l’Europe) de Richard Fitter et Alastair Fitter (texte) et Marjorie Blamey (illustration), éditions Delachaux & Niestlé. (Pour rêver à mon retour dans les champs et les bois).
* Les derniers mots d’un de mes livres préférés :
- Hebdomeros de Giorgio De Chirico (Flammarion, collection l’âge d’or).
« Hebdomeros, le coude appuyé sur la ruine et le menton sur la main, ne pensait plus... Sa pensée, à la brise très pure de la voix qu’il venait d’entendre, céda lentement et finit par s’abandonner tout à fait. Elle s’abandonnait aux flots caressants des paroles inoubliables et, sur ces flots, voguait vers des plages étranges et inconnues. Elle voguait dans une tiédeur de soleil qui décline, souriant dans son déclin aux solitudes céruléennes...
Cependant, entre le ciel et la vaste étendue des mers, des îles vertes, des îles merveilleuses passaient lentement, comme passent les navires d’une escadre devant le vaisseau amiral, tandis que de longues théories d’oiseaux sublimes, d’une blancheur immaculée, volaient en chantant. »
* Les lecteurs blogueurs qui, comme moi, ne pourront peut-être pas résister à l’envie de répondre à ce questionnaire impossible :
- Quatre, ce n’est pas assez : au moins tous ceux et celles qui sont en lien sur ce blog.
En vignette : Photo de Jean Tardieu (par Christian Cottet-Emard)
19:30 Publié dans Et à part ça ? | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : Questionnaire des quatre, livres, littérature, lecture, Jean Tardieu






























